Les enzymes digestives interviennent dans la transformation des aliments que vous consommez. L’amylase est l’une d’entre elles. Elle intervient dès les premières étapes de la digestion des glucides. Mais savez-vous réellement ce qu’est l’amylase, comment elle agit dans votre corps et ce que révèle son taux dans une analyse sanguine ? Découvrez ce qu’est l’amylase et son rôle clé dans la digestion. Suivez le parcours des glucides, de la bouche à l’intestin, grâce à cette enzyme. Apprenez à décrypter une analyse sanguine de l’amylase, à reconnaître les signes d’une digestion affaiblie et à soutenir naturellement sa production.
Qu'est-ce que l’amylase ?
Avant d’aller plus loin, rappelons la définition de l’amylase. Mais c’est quoi exactement l’amylase ?
Il s’agit d’une enzyme digestive produite principalement par les glandes salivaires et le pancréas.
L’amylase est une enzyme digestive dont la mission principale est de couper les glucides complexes, comme l’amidon ou le glycogène, en morceaux plus petits (maltose, maltotriose, dextrines). Ces fragments pourront ensuite être transformés en glucose, la forme de sucre que votre corps utilise comme carburant.
Donc lorsqu’on se demande c’est quoi l’amylase ? On parle d’une enzyme essentielle au bon fonctionnement de votre système digestif et au métabolisme des glucides. [1]
Quel est le rôle de l’amylase dans votre organisme ?
Le parcours d’un glucide de la bouche à l’intestin
La digestion des glucides est un processus en plusieurs étapes, qui mobilise différents enzymes à des moments précis. Ce parcours, de votre bouche jusqu’à l’absorption intestinale, illustre à quel point l’action coordonnée de l’amylase et des autres enzymes digestives est primordiale à l’équilibre énergétique de votre organisme.
Etape | Localisation | Rôle de l’amylase |
Bouche | Salive / cavité buccale | La digestion commence dès la mastication. L’amylase salivaire (ptyaline) entame la coupe de l’amidon en maltose et maltotriose. Son efficacité est optimale dans un pH proche de la neutralité (≈6,7–7,0). |
Œsophage / estomac | Passage vers l’estomac | L'acidité gastrique stoppe l’action de l’amylase salivaire. La digestion des glucides marque une pause. |
Intestin grêle (début : duodénum) | Entrée de l’intestin grêle | Le pancréas envoie de l’amylase pancréatique qui reprend la dégradation des glucides complexes en fragments plus courts (maltose, maltotriose, dextrines). |
Paroi de l’intestin (bordure en brosse) | Surface des cellules intestinales (entérocytes) | Des enzymes fixées sur la paroi (maltase, isomaltase) transforment ces fragments en glucose pur. Le glucose traverse ensuite la paroi intestinale grâce à des transporteurs spécialisés (SGLT1, GLUT2) pour rejoindre le sang. |
Régulation de l’absorption | Toujours dans l’intestin grêle | L’amylase pancréatique peut se fixer aux cellules intestinales et être recyclée. Ce mécanisme aide à moduler la vitesse d’absorption du glucose, afin qu’il ne passe pas trop vite dans le sang. |
Ce tableau met en évidence que l’amylase n’agit pas seule, mais en synergie avec d’autres enzymes et transporteurs spécialisés. Elle prépare le terrain en fragmentant les glucides complexes, permettant ainsi leur conversion finale en glucose, puis leur passage dans la circulation sanguine. [2][3]
Un mécanisme de régulation fin
On pensait que l’amylase servait uniquement à découper l’amidon en sucres simples. Mais des chercheurs ont découvert qu’elle joue aussi un rôle de contrôle dans l’absorption du sucre au niveau de l’intestin. [4]
Une partie de l’amylase pancréatique peut en effet se fixer sur les cellules de l’intestin et freiner temporairement l’entrée du glucose dans l’organisme. Elle est ensuite recyclée à l’intérieur de la cellule et dégradée dans les lysosomes, ce qui permet à l’intestin de reprendre progressivement l’absorption du glucose dans le sang.
Cette action bien décrite dans le tableau ci-dessus a une incidence directe et mesurable sur la vitesse à laquelle le sucre passe votre circulation sanguine après un repas.

Pourquoi c’est important
Ce rôle est essentiel, car la façon dont le glucose passe dans le sang après un repas influence directement votre énergie, votre équilibre métabolique et, à long terme, votre santé.
Cette régulation est importante et agit comme un tampon naturel :
- Il évite que tout le glucose d’un repas arrive d’un seul coup dans le sang, ce qui provoquerait un pic glycémique brutal ;
- Il permet une distribution plus régulière du sucre dans l’organisme (en ralentissant temporairement l’absorption, puis en la relançant progressivement) ;
- Cela donne à votre corps le temps de mieux gérer la glycémie et d’utiliser le glucose de façon plus efficace, sans surcharge immédiate.
Cette double fonction, digestion mécanique des glucides et contrôle de leur assimilation, explique pourquoi le dosage de l’amylase sanguine est un moyen médical important, notamment dans le diagnostic des pathologies pancréatiques.
En pratique, son taux est souvent mesuré pour confirmer ou suivre une pancréatite aiguë, et il peut aussi contribuer à l’évaluation de la pancréatite chronique et de l’insuffisance pancréatique exocrine. [5][6]
Par ailleurs, l’amylase pancréatique peut influencer la vitesse d’absorption du glucose dans l’intestin en modulant l’activité du transporteur SGLT1. Cela suggère un rôle plus large de l’amylase dans le contrôle de la glycémie postprandiale, ouvrant des pistes de recherche intéressantes pour mieux comprendre certains troubles métaboliques comme le diabète ou le syndrome métabolique.
Toutefois, ces applications restent pour l’instant au stade de la recherche fondamentale et ne font pas partie des pratiques cliniques courantes.
L'amylase dans le sang, que signifie une analyse sanguine ?
Pourquoi mesure-t-on l’amylase sanguine ?
Le dosage de l’amylase sérique fait partie des examens biologiques de routine en cas de douleurs abdominales ou de suspicion de problème pancréatique. Il est surtout utilisé pour aider au diagnostic de la pancréatite aiguë, une inflammation brutale du pancréas. Il peut aussi être utile dans la surveillance ou l’orientation diagnostique d’une pancréatite chronique ou d’une insuffisance pancréatique exocrine.
L’amylase peut être mesurée dans le sang, mais aussi dans les urines : on parle alors d’amylasurie. Comme l’amylase est filtrée par les reins, une partie se retrouve en effet dans l’urine. Pendant longtemps, ce test a été utilisé en complément du dosage sanguin.
Mais aujourd’hui, il est beaucoup moins pratiqué (moins fiable pour diagnostiquer une pancréatite aiguë et en cas d’insuffisance rénale, le résultat peut être faussé puisque l’élimination de l’amylase est perturbé).
Les valeurs normales de l’amylase sanguine

Cela signifie qu’un même prélèvement pourrait donner des chiffres légèrement différents d’un centre d’analyse à un autre, sans que cela reflète nécessairement un problème de santé.
Ne vous inquiétez pas en lisant seul ses résultats. Un taux légèrement au-dessus ou en dessous de la norme n’a pas toujours de signification pathologique. Seul un médecin peut interpréter correctement l’analyse, en tenant compte :
- Des symptômes ressentis (par exemple des douleurs abdominales) ;
- Des autres marqueurs biologiques associés, comme la lipase, plus spécifique du pancréas ;
- De votre contexte médical global (antécédents, traitements en cours, état rénal, etc.).
La valeur chiffrée de l’amylase n’a de sens que replacée dans un contexte clinique. Elle est un outil d’orientation, pas un diagnostic en soi.
Quand l’amylase est trop élevée (hyperamylasémie)
On parle d’hyperamylasémie lorsque le taux d’amylase dans le sang dépasse la limite supérieure de la normale (généralement > 110 U/L). [7]
Voici ce que l’on sait à ce jour :
- L’amylase du sang provient à la fois du pancréas (≈ 40 %–45 %) et des glandes salivaires (≈ 55 %–60 %). Une valeur trop élevée ne signifie donc pas forcément un problème pancréatique.
- En cas de pancréatite aiguë, l’amylase est souvent élevée dans environ 75 % des cas, mais ce n’est pas systématique. Certaines pancréatites sévères peuvent présenter un taux normal.
Enfin, une hyperamylasémie ne signifie pas automatiquement une pancréatite. Elle peut survenir dans de nombreuses autres situations (inflammation ou obstruction des glandes salivaires, comme lors des oreillons, insuffisance rénale, macroamylasémie, traumatismes abdominaux, etc.).
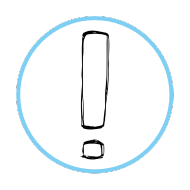
Quand l’amylase est trop basse (hypoamylasémie)
L’hypoamylasémie correspond à un taux d’amylase sanguine inférieur aux valeurs normales.
Moins étudiée que l’hyperamylasémie, elle peut néanmoins fournir des informations intéressantes dans certains contextes cliniques et métaboliques.
Une étude hospitalière a montré que l’hypoamylasémie concernait environ 5,4 % des résultats analysés. Elle était associée à plusieurs conditions, dont le diabète, la mucoviscidose, l’hypertriglycéridémie et l’usage de certains médicaments (par exemple la gentamicine). [8]
De plus, une revue récente souligne que des taux bas d’amylase sont aussi fréquemment observés dans des pathologies métaboliques répandues comme l’obésité, le diabète de type 2 ou le syndrome métabolique.
L’hypoamylasémie pourrait refléter une altération de la fonction pancréatique exocrine, et son lien avec la sécrétion d’insuline suggère une interaction entre les fonctions digestives et hormonales du pancréas. [9]
Les limites du dosage
Le dosage de l’amylase sanguine reste un examen utile, mais il présente plusieurs limites importantes qu’il faut connaître pour éviter toute mauvaise interprétation.
- Manque de spécificité. Une hyperamylasémie ne signifie pas toujours un problème pancréatique. Elle peut aussi provenir des glandes salivaires (oreillons, obstruction), des reins (insuffisance rénale), de l’intestin (occlusion, perforation, péritonite) ou encore d’un phénomène bénin appelé macroamylasémie.
- Sensibilité imparfaite. Environ 25 % des pancréatites aiguës peuvent se manifester avec une amylase normale. Un résultat dans la norme n’exclut donc pas la maladie.
- Influence du moment du prélèvement. L’amylase augmente rapidement dans les 6 à 12 heures suivant une pancréatite, puis redescend en 3 à 5 jours. Un test réalisé trop tôt ou trop tard peut donner un faux négatif.
En conclusion, la lipase sérique serait plus spécifique et resterait élevée plus longtemps que l’amylase. Aujourd’hui, l’amylase seule n’est donc plus considérée comme le meilleur test, mais plutôt comme un examen complémentaire qui doit être interprété dans son contexte clinique.
Quand la digestion des glucides faiblit
Il arrive que la digestion des glucides soit moins efficace, notamment lorsque la production d’amylase diminue. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, une insuffisance pancréatique, l’obésité ou le diabète de type 2.
Quand l’enzyme fait défaut, les amidons sont moins bien dégradés. Une partie de ces amidons atteint l’intestin sans être digérée, ce qui entraîne :
- Ballonnements ;
- Gaz ;
- Douleurs abdominales ;
- Parfois des selles anormales.
Au-delà de l’inconfort digestif, ce déficit peut aussi influencer votre équilibre glycémique, car la transformation du sucre devient irrégulière.
Comment soutenir naturellement votre production d'amylase ?
Même si les recherches humaines restent limitées, certaines habitudes de vie peuvent contribuer à préserver, voire à soutenir, votre production d’amylase et, plus largement, l’efficacité digestive.
Adopter une alimentation équilibrée et modérée en graisses | Des habitudes alimentaires trop riches en lipides diminuent la sécrétion d’amylase, alors qu’une alimentation plus variée et légère semble la stimuler. |
Soigner l’équilibre nutritionnel | Une consommation diversifiée de protéines, glucides complexes et fibres solubles favorise le bon fonctionnement du pancréas et des enzymes digestives. |
Maintenir une flore intestinale saine | Un microbiote intestinal équilibré améliore l’environnement digestif global. Les probiotiques, en contribuant à cet équilibre, peuvent participer à une digestion plus efficace et créer des conditions favorables à l’action des enzymes comme l’amylase. |
Limiter les facteurs irritants. | Alcool, excès de graisses saturées ou aliments ultra-transformés peuvent nuire à la santé pancréatique et, à terme, à la production enzymatique. |
Bouger régulièrement. | Une activité physique modérée soutient le métabolisme global et peut indirectement favoriser la fonction digestive. |

Indispensable. Ce produit est devenu indispensable pour ma santé et mes soucis d'intestin et d'estomac. Règle mes ballonnements et ma flore intestinale. À défaut de prendre d' autre médicament qui ne me faisait plus rien, ça fait 6 mois que j'ai révisé grâce à ce produit.
Maria D.
Amylase : une petite enzyme aux grands impacts
L’amylase assure la dégradation des glucides et participe à la régulation de leur assimilation. Son dosage sanguin aide à explorer la santé pancréatique, même s’il doit toujours être interprété avec prudence et en association avec d’autres marqueurs comme la lipase. Comprendre le rôle de l’amylase, ses variations et ses limites, permet de mieux saisir le lien entre digestion et équilibre métabolique. Enfin, une hygiène de vie adaptée est essentielle pour préserver son efficacité digestive.
Relation of diagnostic serum amylase levels to aetiology and severity of acute pancreatitis
Pancreas-specific plasma amylase for assessment and diagnosis of chronic pancreatitis: New insights on an old topic
Hyperamylasemia
Causes of hypoamylasaemia in a hospital population
Low serum amylase and obesity, diabetes and metabolic syndrome: A novel interpretation













