Parmi les nombreuses maladies qui affectent la digestion, on retrouve la gastroparésie. Une pathologie pas toujours diagnostiquée et qui est parfois confondue avec la dyspepsie fonctionnelle en raison de symptômes similaires. La gastroparésie est caractérisée par une vidange gastrique retardée sans obstruction mécanique. Cet article fait le point sur ses causes, ses symptômes, son diagnostic, ses traitements, et en bonus quelques conseils pratiques pour améliorer votre vie quotidienne.
Qu’est-ce que la gastroparésie ?
La gastroparésie est un ralentissement de la vidange gastrique sans obstruction mécanique de l'estomac ou de l'intestin grêle. Ce trouble de la motilité affecte les muscles de l'estomac et leur capacité à se contracter efficacement pour propulser le bol alimentaire vers l'intestin.
Ce dysfonctionnement digestif provoque des lourdeurs avec une sensation d’estomac plein après quelques bouchées (satiété précoce), des nausées ou vomissements ainsi que des brûlures, des douleurs abdominales, et des ballonnements.
Au cours de la digestion, les aliments sont poussés vers l’intestin grêle par des contractions régulières. En cas de gastroparésie, ils restent plus longtemps que la normale dans l'estomac.

Quelles sont les causes de la gastroparésie ?
Environ 50 % des cas de gastroparésie sont idiopathiques, c’est-à-dire qu'ils ne sont ni la conséquence ni la complication d’une autre. Examinons en détail les causes potentielles.
Diabète de type 1 ou 2
La gastroparésie diabétique est la forme la plus courante, c’est une complication du diabète mal maîtrisé. Elle résulte d'une neuropathie touchant le système nerveux autonome et entérique (intrinsèque), ainsi que les cellules musculaires lisses et les cellules interstitielles de Cajal (ICC) (les pacemaker de l'estomac). Ce dysfonctionnement complexe affecte la coordination nécessaire entre le relâchement du fundus, les contractions de l'antre et l'inhibition du pylore, menant à une diminution des contractions antrales et un ralentissement de la vidange gastrique.
L'hyperglycémie chronique (supérieure à 200 mg/dL) endommage les nerfs (neuropathie autonome), y compris le nerf vague qui contrôle la motilité de l'estomac.

Chirurgie viscérale abdominale
La gastroparésie fait parfois suite à une chirurgie œso-gastrique. On parle alors du syndrome de gastroparésie postchirurgicaleou syndrome de stase gastrique postopératoire, un trouble complexe caractérisé par des nausées et vomissements postprandiaux ainsi qu'une atonie gastrique.
Il est principalement provoqué par une intervention chirurgicale au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, notamment une résection gastrique ou pancréatique.
Il survient parfois après une intervention gynécologique, obstétricale ou suite à une cryoablation du cancer du pancréas. Sa cause reste inconnue et son mécanisme n’est pas totalement élucidé. [3]
Maladies neurologiques
Le système nerveux extrinsèque et le système nerveux autonome contrôlent de manière complexe les principales fonctions digestives via le système nerveux entérique.
Certaines maladies neurologiques, notamment la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l’accident vasculaire cérébral (AVC) et la neuropathie diabétique peuvent donc entraîner des troubles de la motilité gastro-intestinale, y compris la gastroparésie. [4]
Maladies auto-immunes
Des facteurs auto-immuns pourraient être impliqués dans le développement de la gastroparésie, on parle alors de dysmotilité gastro-intestinale auto-immune.
Des études indiquent qu'une forte proportion de patients présentant des symptômes de gastroparésie (jusqu'à 97,9 % dans une cohorte) est positive aux autoanticorps sériques, soulevant la possibilité de maladies auto-immunes non diagnostiquées. [5][6]

Médicaments
La prise de médicaments qui retardent la vidange gastrique est à éviter, ainsi que les opioïdes, la cyclosporine, les phénothiazines, les agonistes de la dopamine, l’octréotide, les agonistes alpha-2-adrénergiques, les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs calciques, les agonistes ou analogues du GLP-1, le lithium et la progestérone. [7]
Les infections virales, notamment le norovirus, le rotavirus et le virus d’Epstein-Barr font également partie des causes possibles.
Symptômes caractéristiques
La gastroparésie est une pathologie sous-diagnostiquée en raison de symptômes non spécifiques, puisqu’ils découlent d’une mauvaise vidange de l’estomac. Si les symptômes cardinaux : nausées, vomissements, satiété précoce et plénitude épigastrique postprandiale deviennent chroniques (persistent plus de 3 mois), on peut suspecter une gastroparésie.
- Nausées et vomissements, qui surviennent plusieurs heures après le repas et contiennent des aliments non digérés.
- Reflux gastrique.
- Satiété précoce, après avoir commencé à manger.
- Plénitude postprandiale : sensation d’un estomac lourd ou plein longtemps après la fin du repas.
- Ballonnements et douleurs abdominales ou épigastriques :des douleurs fréquentes sévères à très sévères au niveau de l'abdomen supérieur ont été rapportées par 34 % des patients atteints de gastroparésie selon une étude. [8]
- Perte de poids involontaire liée à la mauvaise absorption des aliments, à une diminution de l’apport ou à des vomissements.
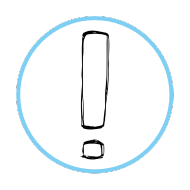
Diagnostic : comment confirmer une gastroparésie ?
L’aspect chronique des symptômes évoqués peut laisser suspecter cette pathologie gastrique.
Analyses et exclusion de l’obstruction
Après un interrogatoire approfondi et un examen clinique, le médecin doit s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction mécanique et exclure d’autres causes potentielles.
- Examens biologiques : bilans de base (métabolique, hépatique, NFS, lipase).
- Imagerie abdominale : tomodensitométrie (TDM) ou IRM pour éliminer d'autres causes de douleurs et de vomissements et, en particulier, une obstruction mécanique d'origine maligne ou autre.
- Endoscopie digestive haute : essentielle pour exclure formellement une étiologie obstructive.
Quantification de la vidange gastrique
Le diagnostic de la gastroparésie est confirmé et quantifié par des tests mesurant objectivement le retard de la vidange.
- Scintigraphie de vidange gastrique : examen de référence pour mesurer objectivement le ralentissement de la vidange gastrique. Le patient ingère un repas solide ou liquide marqué par un radio-isotope et des images sont prises à intervalles réguliers pour suivre la progression des aliments hors de l'estomac.
Classification selon la rétention à 4 h : légère (< 15 %), modérée (15 %-35 %), sévère (> 35 %).
- Test respiratoire de vidange gastrique :le patient ingère un substrat marqué au carbone 13, un isotope stable non radioactif incorporé dans des nutriments. Le marqueur est ensuite mesuré dans l'air expiré.
- Capsule de motilité sans fil (SmartPill) : une capsule à ingérer qui permet de mesurer le temps de vidange, le temps de transit des aliments et les anomalies de motilité grâce à des capteurs qui enregistrent le pH, la température et la pression.
- Échographie : pour examiner les structures anatomiques. [7]

Traitements et conseils
Une approche holistique est recommandée dans la gastroparésie. Le traitement doit débuter par une évaluation nutritionnelle et des changements alimentaires pour corriger rapidement les éventuelles carences hydriques, électrolytiques et nutritives. La priorité est de soulager les symptômes digestifs, d’améliorer la vidange gastrique et de traiter la cause sous-jacente pour prévenir toutes complications de la maladie.
Modifications alimentaires
La première étape consiste à adapter l’alimentation : petits repas fréquents, pauvres en graisse et en fibres, aliments mixés ou liquides.
L’apport de probiotiques rééquilibre le microbiote, améliore le confort digestif en diminuant les ballonnements et l’inconfort abdominal.

Indispensable. Ce produit est devenu indispensable pour ma santé et mes soucis d'intestin et d'estomac. Règle mes ballonnements et ma flore intestinale. À défaut de prendre d'autres médicaments qui ne me faisaient plus rien, ça fait 6 mois que j'ai retrouvé la forme grâce à ce produit.
Maria D.
Médicaments
Les antiémétiques (prochlorpérazine, diphenhydramine, ondansétron) sont utilisés contre les nausées et vomissements.
Le métoclopramide, seul prokinétique validé par la FDA (Food and Drug Administration) pour cette indication, stimule la motricité gastrique mais nécessite une surveillance stricte (risque d’effets secondaires neurologiques).
D’autres molécules sont utilisées hors AMM pour soulager les symptômes, comme la dompéridone, les antidépresseurs à action centrale et le tégasérod, un agoniste partiel des récepteurs 5-HT4.
La dompéridone, un antagoniste des récepteurs D2 de la dopamine, nécessite une surveillance du QTc (risque d’arythmies cardiaques). L’érythromycine, un antibiotique agoniste de la motiline, stimule les contractions péristaltiques gastriques.
Cependant, il expose à une tachyphylaxie rapide et des effets secondaires digestifs et cardiaques.
Autres thérapies
La stimulation électrique gastrique (SEG) réduit les nausées, les vomissements et le besoin nutritionnel, et est efficace chez les diabétiques. Elle nécessite l’implantation d’un stimulateur.
Des interventions chirurgicales (gastrostomie de décompression, jéjunostomie d’alimentation, gastrectomie partielle, pyloroplastie, injection de toxine botulique intrapylorique) sont moins étudiées.
Conseils pratiques
- Arrêter le tabac et l’alcool car ils diminuent la contractilité antrale et ralentissent la vidange gastrique.
- Tenir un journal alimentaire pour identifier les aliments tolérés.
- Éviter les boissons gazeuses, qui augmentent la distension gastrique.
- Privilégier les compotes, les yaourts, les soupes, les fruits et légumes cuits ou mixés.
- Fractionner les repas (5-6/jour).
- Bien s’hydrater entre les repas.
- Marcher après les repas pour stimuler le système digestif.
- Ne pas s'allonger dans les deux heures suivant un repas pour aider la gravité à favoriser la vidange gastrique.
- La maladie peut entraîner de l'anxiété et de la dépression. Un soutien psychologique est parfois nécessaire pour gérer l'impact sur la vie quotidienne.
- Le contrôle du diabète est important en cas de gastroparésie diabétique.
Conclusion
La gastroparésie est une maladie chronique qui affecte la digestion, en particulier la vidange de l’estomac. Qu'elle soit liée au diabète, à une chirurgie, ou de nature idiopathique, ses principaux symptômes sont : nausées, vomissements, satiété précoce et douleurs abdominales. Souvent sous-diagnostiquée, le médecin doit avoir recours à la scintigraphie pour confirmer le diagnostic. Sa prise en charge combine adaptation alimentaire et traitements pharmacologiques. Des signes suspects ? Consultez rapidement.
Clinical Characteristics of Autoimmune Gastroparesis and Response to Immunomodulation
Evaluating Autoimmune Markers in Relation to Gastrointestinal Measures in Patients With Symptoms of Gastroparesis
Gastroparesis
Abdominal Pain in Patients with Gastroparesis: Associations with Gastroparesis Symptoms, Etiology of Gastroparesis, Gastric Emptying, Somatization, and Quality of Life













