De nos jours, le gluten est omniprésent dans l’alimentation. Cette protéine, présente dans de nombreuses céréales comme le blé, l’orge et le seigle, peut parfois être source de troubles digestifs chez certaines personnes. Maladie cœliaque ou intolérance au gluten, quelle différence ? Quels sont les symptômes et comment la diagnostiquer ? Cet article vous aide à comprendre le diagnostic et vous guide pour adopter un régime sans gluten.
Maladie cœliaque, sensibilité, intolérance : de quoi parle-t-on vraiment ?
La maladie cœliaque, la sensibilité au gluten non cœliaque, l’allergie au blé et la simple intolérance au gluten indiquent toutes une souffrance digestive ou extradigestive. Mais qu’en est-il exactement ?
La maladie cœliaque : une maladie auto-immune déclenchée par le gluten
Longtemps considérée comme une affection gastro-intestinale liée à une malabsorption, la maladie cœliaque est aujourd’hui classée comme une maladie auto-immune chronique de l'intestin grêle. Déclenchée par l'ingestion de gluten, une protéine que l’on trouve dans le blé, l’orge et le seigle, elle survient chez des individus génétiquement prédisposés. [1]
Des études montrent que les personnes porteuses des antigènes leucocytaires DQ2 et DQ8 seraient plus susceptibles de développer la maladie.
Lorsque ces patients consomment du gluten, leur système immunitaire réagit anormalement, produisant des anticorps qui attaquent la muqueuse intestinale. Cela provoque une atrophie villositaire, c'est-à-dire une destruction des villosités intestinales, entraînant une malabsorption des nutriments essentiels : micronutriments, vitamines liposolubles, fer, vitamine B12 et folate.
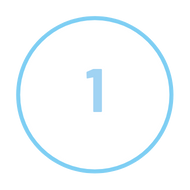
La sensibilité au gluten non cœliaque : quand les tests sont négatifs mais les symptômes bien réels
La sensibilité au gluten non cœliaque (SGNC) est un terme utilisé par les personnes rapportant des symptômes survenant après l’ingestion de gluten, s'améliorant en le retirant de leur alimentation, et n’ayant ni maladie cœliaque, ni allergie au blé.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes suppriment le gluten de leur alimentation suite à un autodiagnostic ou à la suspicion d’une SGNC par un professionnel de santé basée sur des symptômes gastro-intestinaux et extra-intestinaux rapportés après l'exposition au gluten.
Elle est d’ailleurs souvent associée au syndrome de l'intestin irritable, mais la physiopathologie de la SGNC reste floue. Une augmentation de la perméabilité de l'intestin grêle et une activation immunitaire des muqueuses intestinales ont été observées dans certaines études.
Des composants du blé, comme les inhibiteurs de la trypsine d'amylase, pourraient activer le système immunitaire inné et jouer un rôle. Bien que les patients atteints de SGNC n'aient pas les anticorps spécifiques de la maladie cœliaque, certains peuvent présenter des anticorps anti-gliadine qui diminuent avec l'amélioration des symptômes sous régime sans gluten. [3]
L'allergie au blé : une réaction immunitaire immédiate et différente
Contrairement à la maladie cœliaque et à la sensibilité au gluten non cœliaque, l'allergie au blé est une véritable réaction allergique au cours de laquelle les anticorps IgE (immunoglobulines E) interviennent dans la réponse inflammatoire à plusieurs protéines allergéniques.
Les symptômes sont quasi immédiats après l'ingestion de blé, et peuvent affecter la peau (démangeaisons, urticaire, œdème), les voies respiratoires (asthme), le système digestif (vomissements, diarrhée), voire provoquer un choc anaphylactique. [4]
Il existe plusieurs formes d'allergie au blé :
- L'allergie alimentaire IgE-médiée classique (plus rare chez l'adulte), avec des signes digestifs, cutanés et respiratoires, souvent liée aux protéines LTP et aux gliadines.
- L'anaphylaxie au blé induite par l'exercice physique, plus fréquente chez l'adulte et l’adolescent. La consommation de blé est associée à une activité physique (ou d'autres cofacteurs comme les AINS ou l'alcool) pour déclencher la réaction, potentiellement due à une augmentation de la perméabilité intestinale.
- L'allergie alimentaire non-IgE médiée (plus fréquente chez le nourrisson), entraînant des manifestations digestives chroniques comme une entéropathie, des œsophagites ou des gastro-entérites à éosinophiles. [5]
Tableau comparatif pour s'y retrouver
| Maladie cœliaque | SGNC | Allergie au blé |
Nature | Maladie auto-immune | Intolérance fonctionnelle | Allergie alimentaire |
Déclencheur | Gluten | Gluten ou autres composants du blé | Protéines du blé |
Organe cible | Intestin grêle | Intestin | Peau, voies respiratoires, digestives |
Lésions intestinales | Oui (atrophie villositaire) | Non | Non |
Anticorps spécifiques | Anti-transglutaminase, anti-endomysium | Non | IgE spécifiques au blé |
Symptômes | Diarrhées, malabsorption, perte de poids | Ballonnements, douleurs, fatigue | Urticaire, asthme, vomissements, etc. |
Diagnostic | Sérologie, biopsie duodénale | D’exclusion | Tests cutanés, IgE sanguins |
Traitement | Régime sans gluten strict à vie | Régime sans gluten adapté et transitoire | Éviction du blé (pas forcément du gluten) |
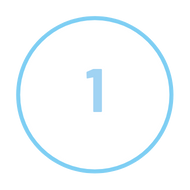
Quels sont les symptômes des troubles liés au gluten ?
Le gluten, signifiant “colle” en latin, est un complexe de protéines (prolamines et gluténines) stockées avec l'amidon dans diverses céréales comme le blé, l'orge et le seigle.
Devenu un sujet d’intérêt scientifique ces dernières années, il est associé à différentes pathologies comme la maladie cœliaque, la sensibilité au gluten non cœliaque, l’ataxie au gluten et la dermatite herpétiforme. [6]
Le saviez-vous ?
La première description moderne complète de la maladie cœliaque a été fournie par le médecin britannique Samuel Gee en 1888. Il a souligné l'importance de la gestion diététique, affirmant que «réguler l'alimentation est l'élément principal du traitement et que si le patient peut être guéri, ce doit être par le régime alimentaire.»
En effet, les symptômes digestifs sont souvent les premiers signes d’une intolérance au gluten.
Les symptômes digestifs classiques
Les premiers symptômes d’une intolérance au gluten sont souvent des troubles digestifs liés notamment à une malabsorption des nutriments due à l’atteinte de la muqueuse intestinale.
- Diarrhées chroniques fréquentes, souvent volumineuses et parfois grasses (stéatorrhée), causées par la mauvaise absorption des graisses.
- Ballonnements et douleurs abdominales persistants, accompagnés parfois de nausées ou vomissements.
- Perte de poids liée à une mauvaise assimilation.
- Chez les enfants, ces symptômes peuvent s’accompagner de retard de croissance, perte d’appétit et fatigue.
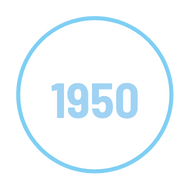
La symptomatologie digestive peut toutefois varier d’un patient à l’autre, certains présentant des formes dites “silencieuses” où les troubles digestifs sont moins marqués mais la malabsorption est néanmoins présente.
Les symptômes extradigestifs parfois surprenants
Les signes d’intolérance au gluten, de maladie cœliaque ou de SGNC sont parfois tout autres. Un des enjeux majeurs du diagnostic est la diversité des signes extradigestifs qui peuvent masquer la maladie.
- Fatigue chronique et maux de tête.
- Anémie ferriprive liée à une mauvaise absorption du fer, même en l’absence de troubles digestifs prononcés.
- Ostéoporose, arthrite, douleurs articulaires, dues à la malabsorption du calcium et de la vitamine D, pouvant entraîner des fractures fréquentes.
- Troubles neurologiques : maux de tête, neuropathies périphériques, troubles de l’équilibre.
- Manifestations dermatologiques : dermatite herpétiforme, aphtes buccaux.
- Troubles de la fertilité et fausses couches à répétition chez les femmes non diagnostiquées.
- Maladies auto-immunes associées : thyroïdite auto-immune, diabète de type 1, maladie hépatique auto-immune. [6]
Ces symptômes peuvent précéder ou dominer la maladie pendant longtemps, d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce pour une prise en charge rapide. Il est parfois nécessaire d’apprendre aux patients à identifier les aliments contenant du gluten et à les sensibiliser sur les sources cachées de gluten présentes dans les médicaments, les compléments alimentaires et les aliments transformés.
Comment diagnostiquer une maladie cœliaque ou une sensibilité au gluten ?
Le diagnostic est une étape fondamentale souvent anxiogène et difficile car les signes de la maladie sont polymorphes et parfois absents. Il repose sur un ensemble de tests et d’examens complémentaires qui doivent être réalisés avant toute modification du régime alimentaire.

Le diagnostic de la maladie cœliaque
Le diagnostic de la maladie cœliaquerepose sur l'analyse de biopsies intestinales, mais le dépistage initial s'effectue par des tests sérologiques.
La sérologie est la première étape visant à détecter des anticorps spécifiques : anti-transglutaminase (anti-tTG) IgA, anti-endomysium (anti-AEM), et anti-gliadine déamidé (DGP). Un dosage des IgA totaux est essentiel pour éviter les faux négatifs.
Individuellement, un seul test n’a pas une spécificité et une sensibilité suffisante pour imposer un régime sans gluten à vie.
S’il s’avère positif, une gastroscopie avec biopsies duodénales et bulbaires est nécessaire chez l'adulte pour confirmer l'atrophie villositaire de la muqueuse intestinale, caractéristique de la maladie cœliaque. En raison de l’atteinte muqueuse hétérogène, plusieurs biopsies sont généralement recommandées. L'augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux sans atrophie villositaire n'est pas spécifique à la maladie.
Chez l'enfant, un taux sérique d'anti-tTG IgA très élevé (plus de 10 fois la limite supérieure de la norme) et d'anti-EMA positifs suffit pour poser le diagnostic de maladie cœliaque sans biopsie.
Le test génétique HLA DQ2/DQ8 est utile en cas de résultats cliniques, sérologiques ou histologiques discordants, ou si le patient suit déjà un RSG. Sa valeur prédictive négative proche de 100%, permet d'exclure une maladie cœliaque si ces haplotypes sont absents. [7]
Des bilans de carences en fer, calcium, vitamines (B9, B12, D) sont souvent réalisés pour évaluer l’impact nutritionnel.
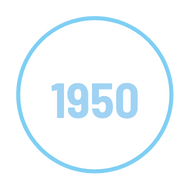
Le diagnostic de la sensibilité au gluten : un diagnostic d'exclusion
Le diagnostic de la sensibilité au gluten non-cœliaque se base sur une amélioration des symptômes suite à l’exclusion du gluten.
- Allergie au blé et maladie cœliaque écartées : tests sérologiques négatifs et biopsie normale.
- Amélioration clinique confirmée par un régime sans gluten strict pendant plusieurs semaines.
- D’autres causes sont également éliminées : syndrome de l’intestin irritable, allergies, infections.
Le diagnostic de SGNC est posé sur la base de la rémission des symptômes avec l’exclusion totale du gluten pendant plusieurs semaines, suivie d'une réapparition des signes d’intolérance lors de sa réintroduction. Ce processus doit être mené sous surveillance médicale pour être fiable.
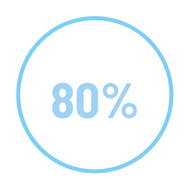
Tableau résumé : symptômes et diagnostic
Trouble | Symptômes digestifs | Symptômes extradigestifs | Examens | Diagnostic confirmé par |
Maladie cœliaque | Diarrhée, stéatorrhée, douleurs abdominales, perte de poids | Anémie, ostéoporose, dermatite herpétiforme, troubles neurologiques, infertilité | Sérologie anti-TG2 IgA + biopsie duodénale | Lésion de la muqueuse intestinale par biopsie |
Sensibilité au gluten non cœliaque | Ballonnements, douleurs abdominales | Fatigue, troubles neurologiques, douleurs musculaires | Sérologie normale, biopsie normale | Amélioration sous régime gluten-free, absence d’auto-anticorps |
Allergie au blé | Douleurs abdominales, vomissements | Urticaire, œdème, choc anaphylactique | Test IgE spécifique au blé, prick-tests | Réaction allergique immédiate confirmée |
L’anamnèse, c’est-à-dire l’étude des antécédents médicaux du malade, est aussi une étape essentielle dans la démarche diagnostique. Elle permet de guider le médecin dans le choix d’examens complémentaires, notamment quand le diagnostic est difficile.
Le régime sans gluten : le seul traitement efficace
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une alimentation saine contribue à protéger l’organisme contre la malnutrition sous toutes ses formes et contre les maladies non transmissibles (diabète, troubles cardiovasculaires).
Le régime sans gluten est actuellement reconnu comme le seul traitement efficace pour soulager les symptômes de la maladie cœliaque.
Il consiste à éliminer tous les aliments en contenant, soit le blé, l’épeautre, le kamut, le froment, l’orge, le seigle, l’avoine et leurs dérivés.
Cette exclusion permet une régénération progressive de la muqueuse de l’intestin grêle et la disparition des symptômes digestifs et extradigestifs.
Cependant, il est important de bien examiner le profil nutritionnel des produits sans gluten disponibles dans le commerce.
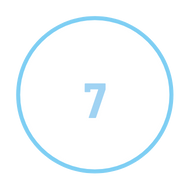
Ce régime nécessite une vigilance renforcée car le gluten est utilisé dans l’industrie agroalimentaire comme additif pour sa texture et sa capacité à retenir l’eau. Cela signifie dire adieu au pain, aux pâtes, aux pizzas traditionnelles, mais aussi à de nombreux produits transformés, sauces et plats préparés où il est souvent utilisé comme épaississant ou liant.
Adopter un régime sans gluten ne se limite donc pas à l'éviction des céréales évidentes. Il est fondamental d'apprendre à lire les étiquettes et à identifier les aliments contenant du gluten caché. De nombreux aliments dits naturellement gluten-free, comme les fruits, les légumes, les légumineuses, la viande, le poisson et les produits laitiers natures, doivent devenir la base de votre alimentation.
L’inconvénient majeur est que cette restriction peut parfois entraîner des carences en fibres, en vitamines B, en fer, en magnésium et en calcium, surtout si le régime n'est pas bien équilibré.
Pour pallier ces carences potentielles et soutenir l'organisme, un apport en micronutriments est essentiel. Nos multivitamines sont un incontournable avec 21 nutriments, dont 12 vitamines et 5 minéraux pour une action synergique sur votre métabolisme énergétique.

Le tir nécessite une concentration extrême et une santé de fer. Le multivitamines Nutripure reste pour le moi le meilleur sur le marché. Je ne tombe plus malade en hiver et je peux rester concentré sur mes entraînements.
Jean Quiqampoix - Champion Olympique de Tir Sportif, Tokyo 2020
Les aliments à éviter et ceux à privilégier
Groupe d’aliments | À bannir | À sélectionner |
Céréales | Blé, seigle, épeautre, orge, kamut, triticale | Riz, maïs, sarrasin, quinoa, millet, amarante |
Produits transformés | Pains, brioches, pâtes, biscuits, sauces industrielles | Légumes, fruits, viandes fraîches, œufs, produits laitiers natures |
Substituts | Farine de blé, chapelure classique | Farines de riz, maïs, pois chiche, poudre d’amande |
Additifs cachés | Certains arômes, amidons modifiés, sauces épaissies | Gomme de guar, liants végétaux certifiés sans gluten |
Régime sans gluten : bienfaits et risques
Les études confirment que le respect strict du régime sans gluten est bénéfique à la fois sur la qualité de vie et diminue le risque de complications. Les symptômes digestifs et extradigestifs disparaissent habituellement dans les jours ou les semaines suivant le début de sa mise en place.
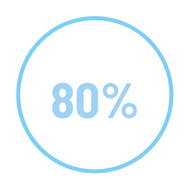
Une surveillance est nécessaire même après disparition des symptômes et consiste à :
- Évaluer les signes résiduels et prévenir les complications potentielles comme l'ostéoporose ou d'autres maladies auto-immunes (diabète de type 1, troubles thyroïdiens).
- Vérifier la séroconversion, c'est-à-dire la normalisation des taux d'anticorps spécifiques de la maladie cœliaque.
- Surveiller la régression de l'atrophie villositaire, objectif thérapeutique majeur pour prévenir des complications graves à long terme, ce qui prend en moyenne 3 ans après l’exclusion du gluten. [7]
En l’absence de maladie cœliaque ou de sensibilité confirmée, un régime “noglu” expose à des risques de carencesen fibres alimentaires, vitamines B, fer, calcium et peut engendrer des déséquilibres nutritionnels importants et potentiellement augmenter le risque de troubles cardiovasculaires, privant l’organisme des céréales complètes et de leur effet protecteur.
Les professionnels recommandent donc de ne jamais débuter ce régime sans avis médical et de surveiller la composition des produits “gluten free”, souvent pauvres en fibres et enrichis en sucres et lipides pour compenser la perte de texture.
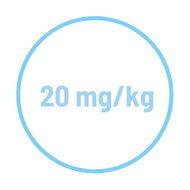
De nombreuses personnes, y compris celles qui n'ont pas la maladie cœliaque ou une sensibilité au gluten, adoptent un régime sans gluten. Ce phénomène s'explique en partie par la perception erronée, véhiculée par les médias, qu’adopter ce régime alimentaire serait intrinsèquement un mode de vie plus sain.
En fait, bien que la prévalence de la maladie cœliaque soit estimée à 1%, jusqu'à 5% de la population déclare suivre un régime sans gluten de son propre chef.
Malheureusement, ce choix, qu'il soit médicalement indiqué ou non, entraîne généralement une augmentation du coût des aliments, une diminution de la consommation de fibres, une diminution potentielle de l'apport en minéraux et vitamines, notamment en calcium, magnésium, zinc, vitamine B12, folate et vitamine D, et une exposition potentiellement accrue aux acides gras saturés et hydrogénés, ainsi qu'à l'arsenic.
Adopter un régime sans gluten n'est donc pas sans risque. [8]
Régime strict ou adapté ?
Il va de soi que les habitudes alimentaires doivent être adaptées et qu’un régime sans gluten strict n’est requis qu’en cas de maladie cœliaque confirmée. Voici un tableau comparatif des restrictions :
| Nature de la maladie | Protéine incriminée | Traitement et régime | Niveau de restriction |
Maladie cœliaque | Auto-immune | Gliadines et gluténines | RSG strict à vie | Total, la moindre contamination croisée est à éviter. |
Allergie au blé | Allergie alimentaire Réaction immunologique | Protéines du blé : gluten, albumines, globulines, etc. | Éviction du blé | Éviter tout aliment dérivé du blé. |
Sensibilité au gluten non cœliaque | Réponse symptomatique à l’ingestion de gluten | Gluten | RSG modulable | Adaptable par petites quantités selon tolérance. |
Vivre sans gluten au quotidien : conseils et astuces
Éliminer le gluten de votre quotidien demande des sacrifices et l’observance d’un régime sans gluten peut s’avérer difficile car l’exposition involontaire est fréquente.
Cependant, il faut savoir que la non-observance, qu’elle soit intentionnelle ou accidentelle, est la principale cause d’échec thérapeutique. Découvrez ici quelques conseils pratiques pour vivre votre régime sans prise de tête.

Gérer les repas à l'extérieur
Manger au restaurant ou être invité chez quelqu’un quand on est atteint de maladie cœliaque ou de sensibilité au gluten peut sembler compliqué, mais ce n'est pas impossible.
- Recherchez en amont : de nombreuses applications et sites web répertorient les restaurants qui proposent des options sans gluten.
- Informez le personnel de votre intolérance au gluten ou de votre maladie cœliaque et demandez la composition exacte des plats en faisant attention aux sauces, marinades et panures.
- Faites le choix d’aliments naturellement gluten-free comme des plats à base de viande, de poisson et de légumes frais qui sont souvent des choix plus sûrs.
- Emportez un encas avec vous pour avoir toujours des aliments sans gluten en cas d'imprévu
.
Cuisiner à la maison
- Préparez vos repas pour mieux contrôler la composition et éviter les contaminations croisées.
- Alternez céréales, légumineuses et tubercules pour couvrir l’ensemble des besoins nutritionnels.
- Privilégiez les aliments bruts et naturels.
- Pour les snacks ou les petits déjeuners, privilégiez les granolas, crackers et encas riches en graines.
- Utilisez des farines alternatives (riz, maïs, pois chiche, sarrasin) et des liants végétaux certifiés.
Les alternatives et produits sans gluten : comment bien les choisir ?
Il existe de nombreuses alternatives et produits sans gluten, toutefois il faut bien lire les étiquettes. Recherchez :
- La mention “sans gluten” ou le logo officiel (épi de blé barré).
- La liste d’allergènes (en gras dans la composition)
- Des listes courtes avec des ingrédients essentiels.
Prêtez attention aux :
- Termes ambigus comme “protéines végétales”, amidon modifié, etc.
- Mentions “peut contenir des traces de gluten”. Risque de contamination croisée.
- Nouvelles recettes.
Alternatives naturelles aux aliments avec gluten
Les céréales et pseudo-céréales :
- Quinoa : riche en protéines complètes et en acides aminés essentiels, source de fibres et de minéraux.
- Riz (complet ou blanc) : fortement digestible, source de fibres et de vitamines B.
- Maïs : grains, farine, semoule (polenta), riche en antioxydants et vitamines B.
- Millet, amarante, sarrasin : diversifient les textures, apportent magnésium, phosphore et protéines.
Les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) apportent des protéines végétales, des fibres et des minéraux intéressants.
Les farines de substitution sont nombreuses et se prêtent à des usages variés en cuisine :
- Farine de riz : très polyvalente pour pâtisseries légères, associée à d’autres farines pour un équilibre parfait.
- Farine de maïs : goût sucré, idéale en association dans les biscuits ou gâteaux.
- Farine de sarrasin : parfaite pour les préparations salées ou les galettes.
- Farine d’amande ou de coco : riches en protéines, idéales pour pâtisseries, apportent texture et saveur.
Une semaine de menus sans gluten pour vous simplifier la vie
| Petit-déjeuner | Déjeuner | Dîner |
Lundi | Lait végétal + flocons de sarrasin + fruits rouges | Nouilles de riz accompagnées de légumes + tofu fumé ou œufs brouillés + yaourt nature | Wraps de maïs sans gluten, laitue, saumon fumé, cottage cheese + soupe de légumes + salade de fruits |
Mardi | Pancakes à la farine de riz avec sirop d’érable et fruits | Escalope de poulet et champignons accompagnée de riz sauvage + emmental + pomme | Pommes de terre et chou-fleur en gratin et lardons + salade + compote |
Mercredi | Porridge de quinoa et fruits frais | Jardinière de légumes et pavé de saumon + semoule de maïs + fromage blanc et pépites chocolat (sans gluten) | Patates douces rôties, épices, miel + riz basmati + flan pâtissier sans pâte |
Jeudi | Muffins à la farine de coco + fruits + yaourt grec | Filet de lieu noir + quinoa + légumes rôtis (carottes, patates douces, panais) + yaourt nature avec un soupçon de miel | Chili con carne simple + pomme |
Vendredi | Œufs brouillés aux légumes | Quiche aux poireaux sans pâte + salade + smoothie banane-fraise | Salade de riz au thon + légumes verts et vinaigrette maison + crème chocolat |
Samedi | Chia pudding + carré chocolat 70 % | Carottes râpées Tofu caramélisé Riz basmati Banane | Pizza Marguerite (pâte chou-fleur ou patate douce) |
Dimanche | Pancakes à la farine de châtaigne + fruits | Salade concombres-feta + risotto poireaux-crevettes + entremets vanille | Chakchouka + salade verte + pomme |
Ces menus ne sont bien sûr pas exhaustifs, vous pouvez simplement vous en inspirer pour vos recettes. Ils valorisent les aliments naturellement gluten-free tout en garantissant un apport suffisant en fibres, protéines et micronutriments. Pour limiter les carences fréquentes dans les régimes exclusifs, une supplémentation en multivitamines est vivement conseillée.
Conclusion
Vous connaissez maintenant les 3 pathologies provoquées par le gluten : maladie cœliaque, sensibilité au gluten non cœliaque et allergie au blé. Leurs symptômes analogues rendent le diagnostic parfois difficile.
Les différences ?
Maladie cœliaque = entéropathie auto-immune déclenchée par l’ingestion de gluten.
SGNC = mêmes signes s’améliorant dès l’arrêt de la consommation de gluten.
Allergie au blé = réaction allergique immédiate aux composants du blé.
Le régime sans gluten est le seul traitement efficace qui permet aux personnes souffrant de ces maladies de retrouver une vie normale. En revanche, il ne doit jamais être adopté sans avis médical car il provoque des carences et des déséquilibres nutritionnels.
Intolérance, hypersensibilité, allergie au gluten : comment s’y retrouver ?
Gluten-Associated Medical Problems
Diagnostic et traitement de la maladie coeliaque : mise à jour des recommandations américaines (American college of gastroenterology)
A Gluten-Free Diet, Not an Appropriate Choice without a Medical Diagnosis









